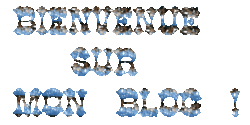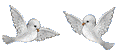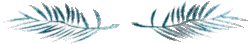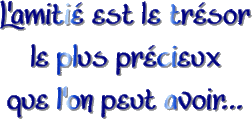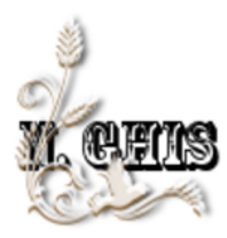-
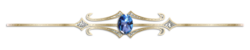
Ce qu’elle craignait le plus, c’était la d’Argenson qui ne cachait pas qu’elle comptait sur le décès de l’aïeule pour faire mains basses sur l’héritage et le fameux trésor de la princesse hindou par tous les moyens, quitte à faire démolir la vieille tour carrée jusqu’à ce qu’elle trouve ce qu’elle y cherchait. Les joyaux serait, pour elle, la récompense suprême pour avoir attendu toutes ces années que cette vieille chouette meurt. Peu lui importait l’appartement de la comtesse, la chambre d’Adélaïde ou d’Isabelle, et encore moins le lieu ou habitait la sœur de son époux qui était infirme, et dont elle n’avait que faire ! Elle voulait le trésor et tout ce qui appartenait aux deux familles de Rubens.
Pour réussir à réunir les deux domaines en un seul, il était primordial de faire accepter sa fille en mariage par William afin que, par des manières détournées, elle puisse aussi, faire mains basses en temps voulu, sur la propriété d’Aigue-blanche par des moyens détournés. Son plan était de devenir, tôt ou tard, avec sa fille, les deux la châtelaines incontestées de tous les domaines réunis des de Rubens. Ce ne devait pas être trop difficile de charmer le jeune homme en se montrant affable et conciliante envers son futur beau-fils…
Isabelle, connaissant très bien les manières de faire de la d’Argenson afin d’obtenir ce qu’elle désirait par-dessus tout. Se méfiait d’elle. La jeune comtesse sentait bien que quelque chose se tramait, d’où sa méfiance envers la mère et la fille qui avaient des personnalité similaires. Ce qu’elle ne comprenait pas : tout au moins, pas encore, c’était jusqu’où sa cupidité et sa fourberie pouvais aller en jouant la comédie de la future gentille belle-mère, de la femme énamourée devant son époux lorsqu’elle avait besoin de se faire plaindre, ou d’avoir son approbation, surtout en ce qui la concernait, elle, Isabelle… Cette femme minaudait, déployait toute sa séduction pour amener son mari à considérer les choses de son point de vue.
C’est que la d’Argenson, comme la surnommait la jeune comtesse, était très rusée. Elle savait s’y prendre pour tenir son époux épris d’elle, et obtenir tout de qu’elle désirait de lui. Il faut dire qu’elle avait un atout majeur que sa belle-fille ne pouvait, à seize ans, comprendre. Elle était vénale, et pour réussir dans ce qu’elle entreprenait, elle se servait de jeux amoureux : elle aimait l'amour et savait se faire désirer. Elle adorait s’adonner aux jeux sexuels. Dans ces moments-là, Rudolph était en adoration devant sa femme qui savait lui donner du plaisir lorsqu’il lui faisait comprendre qu’il la désirait et qu'il aspirait à ces instants de tendre complicité...
37

 votre commentaire
votre commentaire
-
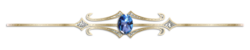
Ce qu’elle craignait le plus, c’était la d’Argenson qui ne cachait pas qu’elle comptait sur le décès de l’aïeule pour faire mains basses sur l’héritage et le fameux trésor de la princesse hindou par tous les moyens, quitte à faire démolir la vieille tour carrée jusqu’à ce qu’elle trouve ce qu’elle y cherchait. Les joyaux serait, pour elle, la récompense suprême pour avoir attendu toutes ces années que cette vieille chouette meurt. Peu lui importait l’appartement de la comtesse, la chambre d’Adélaïde ou d’Isabelle, et encore moins le lieu ou habitait la sœur de son époux qui était infirme, et dont elle n’avait que faire ! Elle voulait le trésor et tout ce qui appartenait aux deux familles de Rubens.
Pour réussir à réunir les deux domaines en un seul, il était primordial de faire accepter sa fille en mariage par William afin que, par des manières détournées, elle puisse aussi, faire mains basses en temps voulu, sur la propriété d’Aigue-blanche par des moyens détournés. Son plan était de devenir, tôt ou tard, avec sa fille, les deux la châtelaines incontestées de tous les domaines réunis des de Rubens. Ce ne devait pas être trop difficile de charmer le jeune homme en se montrant affable et conciliante envers son futur beau-fils…
Isabelle, connaissant très bien les manières de faire de la d’Argenson afin d’obtenir ce qu’elle désirait par-dessus tout. Se méfiait d’elle. La jeune comtesse sentait bien que quelque chose se tramait, d’où sa méfiance envers la mère et la fille qui avaient des personnalité similaires. Ce qu’elle ne comprenait pas : tout au moins, pas encore, c’était jusqu’où sa cupidité et sa fourberie pouvais aller en jouant la comédie de la future gentille belle-mère, de la femme énamourée devant son époux lorsqu’elle avait besoin de se faire plaindre, ou d’avoir son approbation, surtout en ce qui la concernait, elle, Isabelle… Cette femme minaudait, déployait toute sa séduction pour amener son mari à considérer les choses de son point de vue.
C’est que la d’Argenson, comme la surnommait la jeune comtesse, était très rusée. Elle savait s’y prendre pour tenir son époux épris d’elle, et obtenir tout de qu’elle désirait de lui. Il faut dire qu’elle avait un atout majeur que sa belle-fille ne pouvait, à seize ans, comprendre. Elle était vénale, et pour réussir dans ce qu’elle entreprenait, elle se servait de jeux amoureux : elle aimait l'amour et savait se faire désirer. Elle aimait s’adonner aux jeux sexuels. Dans ces moments-là, Rudolph était en adoration devant sa femme qui savait lui donner du plaisir lorsqu’il lui faisait comprendre qu’il la désirait et qu'il aspirait à ces instants de tendre complicité...
38

 votre commentaire
votre commentaire
-
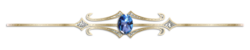
C’est alors que, par la porte communicante de leur chambres il allait la rejoindre, grisé par l'envie qu'il avait d'elle. Cette porte n’était pas pour déplaire à la d’Argenson qui aimait les rapprochements intimes avec cet homme en adoration devant elle. Dans leurs tendres moments d’intimité, elle savait se mettre en valeur devant lui, d’autant plus qu’elle adorait le voir à ses genoux, fou de désir lorsqu’il s’agissait de lui faire l’amour. La d’Argenson était une femme qui aimait être désirée. Elle prenait un soin tout particulier à sa toilette pour les rendez-vous nocturnes avec son époux. Elle choisissait des tenues de nuit affriolante tout en étant très raffinées. La dentelle ajourée, dans des tons de blanc immaculé allant bien avec sa carnation de brune, laissait deviner ses formes en transparence, ce qui excitait le comte, comme beaucoup d’hommes envahit de pensées folles.
Allongée sur son lit à baldaquin ou elle se prélassait, alanguie, avec toute la subjectivité de sa nudité offerte. Elle prenait des poses aguichantes, les yeux mi-clos, passant avec sensualité sa langue sur ses lèvres offertes, aguichant son mari qui ne pouvait résister à cet appel tout en gestes l’invitant à l’amour. Édith d’Argenson aimait se laisser découvrir avec toute la finesse dont elle était capable en ces instants de plaisir. A l’intérieur d’elle-même, c’était tout autre chose ! C’était une fleur vénéneuse, nourrissant en son cœur un poison violent et mortel qu’elle se gardait bien de dévoiler au comte qui trouvait sa femme belle de partout, et qui ne pouvait rester insensible à sa beauté extérieur. Après leurs ébats torrides, tous deux se reposaient un moment en s’abreuvant de mot d’amour tout en se donnant la béqué. La table était bien garnie en fruits de saison, de petits fours, sans oublier le champagne que Rudolph aimait laper sur le nombril de sa belle. Cela finissait de les émoustiller, les entraînant, de nouveaux, dans leurs jeux amoureux. Leurs rapprochements, dans ces moments-là, étaient ardents. Plus tard, épuisés et comblés, ils se laissaient glisser dans un sommeil réparateur, nus, juste recouverts d’un drap de satin. Lorsque l’aube pointait, Rudolph, reposé de leurs ébats amoureux de la nuit, il désirait encore sa femme et leurs jeux amoureux reprenaient pour se prolonger assez loin dans l’après-midi.
Vers les 17 heure, le comte et la comtesse faisaient leur apparition, aimables, au mieux de leur forme, toilettés, habillés pour la circonstance, et à l’heure pour le thé : moment sacré chez les de Rubens. Par habitude, toute la domesticité était au courant de leurs folles nuits d’amour qui se répétaient, d’ailleurs, assez souvent.
39

 votre commentaire
votre commentaire
-
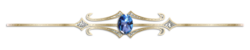
Derrière leur dos, les domestiques ne se gênaient pas pour jaser sur leur compte à tous propos. Ils se faisaient des gorges chaudes de tout ce qu'ils avaient entendu en passant et repassant dans les couloirs ou bien, devant leurs portes. Ils se régalaient des papotages entendus par les chambrières qui se faisaient un malin plaisir d'aller propager dans les cuisines, au moment des repas de la domesticité, ce qu’elles avaient surpris d’assez sensuel et croustillants chez leurs employeurs. Par contre, rigide dans leurs costume de circonstance comme l’exigeait le protocole Anglais, le personnel affilié au service des châtelains, étaient à leur disposition pour leurs servir la collation de dix sept heure (téa in afternoon), comme cela se faisait beaucoup et se fait encore chez les nobles.
40

 votre commentaire
votre commentaire
-
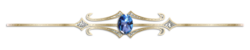
Isabelle se concentra pour mieux entendre sa voix supplier de plus belle. Elle hésitait toujours, se demandant si elle pouvait se permettre d’être au chevet de son aïeule en même temps que lui. Elle était inquiète. Que dirait son père la voyant au chevet de sa grand-mère qui était à l'agonie, alors que ce qu’il avait d’important à lui arracher de la bouche ne la regardait pas ? Après tout, elle était une de Rubens ! Même si son père et sa marâtre la traitait comme une personne insignifiante, elle se devait d’être là. De plus, elle connaissait la raison pour laquelle son père se devait d’être déjà aupré de sa mère afin de recueillir ses dernières paroles, et ce n’était pas du tout par affection. Oh ! Non ! Il s’agissait, et elle en était sûr, des bijoux de la princesse dont les origines se trouvaient être les Indes Orientales, à l'époque des colonies Anglaise.
Comme elle s’appliquait à observer celle qui lui avait fait confiance au point de lui avoir confié ses secrets et ce qu'elle comptait faire de sa fortune avant de s’en aller, elle entendit de nouveau la voix de son père, impérative et suppliante à la fois, ce qui l’irrita au plus haut point.
— Mère ! Répondez-moi ! Il y a beaucoup à faire dans ce genre de demeure et je n'ai pas les fonds nécessaires. Mère, je vous en supplie ! Avant de vous en aller, consentez à m'aider financièrement afin que je puisse, à mon tour, entretenir le château de nos ancêtres ! Ces bijoux ne vous servent plus à rien à présent. Ma mère, m’entendez-vous ? Mère ! Je vous en prie ! Je vous en supplie ! Ne pouvez-vous me dire un mot avant de vous en aller ?
Ne pouvait-il pas la laisser en paix ?! La curiosité étant la plus forte, elle se devait de rester jusqu’à la fin. Ses insistances la mettait très mal à l’aise. Mais rien ne semblait émouvoir la mourante. La jeune comtesse ne perdait rien de la scène dont elle était témoin. Elle entendait distinctement la voix haletante de son père qui suppliait, suppliait et suppliait encore en pressant sa mère de parler.
Qu’elle ne fut pas sa stupéfaction, lorsqu’elle comprit que son père insisterait jusqu’au dernier souffle de sa mère pour savoir où se trouvaient les bijoux. Elle n’en revenait pas de voir à quel point il insistait pour obtenir une réponse de sa mère à l’agonie. Son insistance était, pour Isabelle, si indélicate, qu’elle en était outrée. Elle dû se contenir pour ne pas dévoiler sa présence pendant que son père harcelait sa grand-mère :
— Mère ! Je vous en prie ! Je vous en supplie ! Ne pouvez-vous me dire un mot ?
Soudainement, la main d'Isabelle se crispa sur le battant de cette même petite porte. Là-bas, à l’extrémité de la chambre, apparaissait la souple silhouette de la d’Argenson vêtue de crêpe jaune pâle. Elle semblait glisser sur le vieux tapis d’Orient. Elle était défigurée par sa cupidité. Sa bouche était serrée, ses yeux chargés d’une âpre inquiétude durcissaient étrangement ses traits.
Rudolph se redressa, tournant sans s'en rendre compte le dos à sa fille qui ne quittait pas le lit de la mourante des yeux. sa belle-mère, tout en avançant, demanda d’une voix pressante :
— Vous n’avez pas réussi ?
— Non ! Je crois du reste qu’elle ne peut plus parler.
— Elle ne peut plus ? Allons donc, si elle le voulait !
Jamais Isabelle ne devait oublier la haineuse fureur contenue dans cette voix. Dans son regard dirigé vers la mourante, pointait une haine trop longtemps contenue.
— Il ne nous reste plus qu’à espérer les trouver en commençant les fouilles dès maintenant ?
— Dès maintenant ?
Il y avait une hésitation dans la voix de Rudolph.
— Non, Edith, mieux vaut attendre qu’elle...
— Pas du tout. On ne sait si ses domestiques ne pendraient pas les devants. Je sonne Angèle pour qu’elle nous remette les clefs.
A cet instant, Isabelle, qui regardait sa grand-mère, vit ses paupières se lever l’espace d’une seconde, ses lèvres se fermer pour esquisser un étrange rictus dans une sorte d’affreux rire silencieux. La jeune comtesse laissa aller le battant de la petite porte le plus silencieusement possible et s’enfuit sans bruit, le cœur étreint par une profonde vision d’horreur.
59


 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La plume de N. Ghis. dans " Le mystère de l'étang-aux-ormes " Chapitre -1- page -1- le 20 Juillet 2020 à 10:09
Le comte Rudolph, lui, menait grande vie avec sa deuxième femme, et ne vivait uniquement que pour elle et sa belle-fille Ludivine de seulement deux ans plus âgée que la petite Isabelle.
Depuis cette tragédie survenue dix ans au paravent, les années s’étaient écoulées dans une atmosphère de solitude affective pour Isabelle. Aujourd’hui, la jeune comtesse était une adolescente au caractère bien affirmé, déjà très belle et très intelligente. Adélaïde avait reporter toute son attention et son affection sur cette petite fille qu’elle avait vu grandir en solitaire, s’endurcissant un peu plus chaque jour qui s’écoulaient, manifestant une indépendance marquée, et un mépris total pour les convenances envers celles qui avaient la prétention de remplacer sa mère. Quant au comte Rudolph marquant une indifférence marquée et plus que choquante à l’égard de sa fille, celle-ci s’était braquée, ne supportant plus, et ce, depuis longtemps, son autorité. Isabelle n’éprouvait que du mépris et de la révolte contre les nouvelles règles instituées par la d’Argenson.
Lorsque Isabelle leva ses yeux vers Adélaïde, ils étaient assombris, durcit par la rage qui se lisait sur son visage. Elle était sa seule amie, celle qui l’avait élevé seule toutes ces longues années, et ne pouvait s’empêcher d’analyser les dégâts psychologiques que la d’Argenson et le comte s’ingéniaient à provoquer chez la jeune fille.
l’adolescente eu soudain une prise de conscience sur l’état actuel de la situation dont elle subissait les conséquences. Ce qui lui fit faire ce constat :
— Adélaïde, ce n'est que du malheur qui est entré dans cette demeure depuis que mon père à épousé cette Édith d'Argenson ! Je la méprise ! Elle ne porte le patronyme de mon père que parce qu'il a eut la faiblesse de lui offrir le mariage et qu’il à fait d’elle une femme honorable en apparence car, à l’intérieur d’elle-même, ce n’est que laideur. D’après ce que je sais d’elle. Cette femme n’a aucune conscience. Elle est orgueilleuse et elle à le fond méchant. Elle se garde bien de montrer ce qu’elle à de néfaste en elle à mon père ! Elle s’est, pour tous ses précédents mariage, faite épouser pour avoir un titre de noblesse à exhiber. Ce qui lui importait, était de faire partie de l’élite dont le nom est le garant d’une très bonne lignée ; mais elle n’est pas née noble !
— Vous avez découvert cela aussi ?
— Oui, et il n’y a pas si longtemps. Je sais bien d’autres choses ma bonne Adélie…
60

 votre commentaire
votre commentaire
-
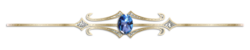
Les lèvres brûlantes de William se posèrent irrésistiblement sur celles d'Isabelle, l’empêchant de terminer sa phrase. Il l’avait prise dans ses bras alors qu’elle était prête de défaillir. Ce chaste baiser l'avait bouleverser.
Il relâcha son étreinte en prenant soin de retenir sa cousine qui vacillait. Jamais la jeune fille n’avait été embrassée ? Elle était troublée, défaillante, et ne comprenait plus le revirement de son cousin.
— William, pourquoi ? !
— Pardonnez moi Isabelle ! Mes sentiments ont submergés ma volonté. J’ai deviné ce que vous ressentez à mon égard et je sais très bien qu’il ne peu rien y avoir entre nous à cause de ce simulacre de mariage qu'est le miens. Je vous aime, Isabelle ! C'est très dur de vous voir, de ne pas vous parler librement ! Hélas, je vous sais en danger. Il vous faut partir ! Ludivine peut vous nuire, Isabelle. Elle le peut… il faut vous méfier de sa mère autant que d'elle ! Oh ! Mon tendre amour !
Les lèvres de William avaient, de nouveau, pris les siennes, les caressant tendrement, amoureusement. Isabelle ne pouvait plus se séparer de celui dont le regard perçant, dans ce clair-obscur, l’hypnotisait. Toute retournée, elle essaya de retrouver ses esprits en le suppliant :
— William, je… que… faites-vous ? Vous… vous savez bien… que... pour nous… que... que c’est impossible... je vous en supplie... je ne saurais vous résister si... vous-même... vous n'avez pas la force de... combattre cet amour pour nous deux... il ne faut plus nous voir, William !
— Ma douce ! Je préfère vous voir partir ; mais au fond de moi, je ne le veux pas. Ne plus vous voir serait trop dur et pourtant, il le faut ! Pardonnez-moi pour cet instant d’égarement ! J’ai perdu la tête à votre contact. Cela fait si longtemps ! Vous sentez que ce que nous éprouvons l’un pour l’autre est très fort ! Il est dur de se voir et de ne pas succomber à notre attirance mutuelle ! J’ai tant lutté pour ne plus vous rencontrer autant qu’avant Isabelle… Je jouais même l’indifférent tout en vous regardant souffrir. C’est très dur de vous savoir à Monteuroux et de ne pas vous approcher de peur d’être surprit par Ludivine comme l’autre jour. Ne pas pouvoir vous prendre dans mes bras m’est insupportable ! Depuis que vous êtes revenues d’Angleterre changée en une magnifique jeune femme si belle, si douce, je ne pense qu’à vous. J’aime votre caractère, vos réparties, vos goûts, votre sourire… j’aime tout de vous ! Comment pourrais-je ne plus vous regarder, vous approcher, vous serrer dans mes bras ?
— Il ne faut plus William. Il y a un gros obstacle que nous ne pouvons franchir… et nous sommes en faute vis à vis de votre femme et de l’église.
Les lèvres brûlantes de William se posèrent irrésistiblement sur celles d'Isabelle, l’empêchant de terminer sa phrase. Il l’avait prise dans ses bras alors qu’elle était prête de défaillir. Ce chaste baiser l'avait bouleverser.
Il relâcha son étreinte en prenant soin de retenir sa cousine qui vacillait. Jamais la jeune fille n’avait été embrassée ? Elle était troublée, défaillante, et ne comprenait plus le revirement de son cousin.
— William, pourquoi ? !
— Pardonnez moi Isabelle ! Mes sentiments ont submergés ma volonté. J’ai deviné ce que vous ressentez à mon égard et je sais très bien qu’il ne peu rien y avoir entre nous à cause de ce simulacre de mariage qu'est le miens. Je vous aime, Isabelle ! C'est très dur de vous voir, de ne pas vous parler librement ! Hélas, je vous sais en danger. Il vous faut partir ! Ludivine peut vous nuire, Isabelle. Elle le peut… il faut vous méfier de sa mère autant que d'elle !
Oh ! Mon tendre amour !
Les lèvres de William avaient, de nouveau, pris les siennes, les caressant tendrement, amoureusement. Isabelle ne pouvait plus se séparer de celui dont le regard perçant, dans ce clair-obscur, l’hypnotisait. Toute retournée, elle essaya de retrouver ses esprits en le suppliant :
— William, je… que… faites-vous ? Vous… vous savez bien… que... pour nous… que... que c’est impossible... je vous en supplie... je ne saurais vous résister si... vous-même... vous n'avez pas la force de... combattre cet amour pour nous deux... il ne faut plus nous voir, William !
174


 votre commentaire
votre commentaire
-
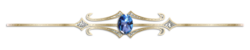
Une porte s’ouvrit derrière la jeune comtesse.
— Antoinette voudrait vous parler, dit Adélaïde.
— Dites-lui d’entrer Adélie. Antoinette pénétra dans la chambre de Isabelle, et lui tendit un rouleau de papier :
— Mlle Victoria envoie cela à Mlle Isabelle pour qu’elle le lise tout de suite.
— Ah ! Bien, Antoinette. Ma tante est-elle vraiment au plus mal ? Risque t-elle de nous quitter dans les jours qui vont suivre ?
— Elle va tout à fait mal. Je lui change ses draps tous les jours, tellement elle transpire. La fièvre ne descend pas. Elle vient en outre de se fatiguer pour écrire ces pages qu’elle voulait à tout prix vous faire porter. Je l’ai soutenu comme j’ai pu, mais elle à eu beaucoup de peine pour arriver à la fin.
La voix d’Antoinette se brisait. Sur son visage altérée par le chagrin, on discernait la fatigue accumulée par un dévouement qu’elle ne ménageait pas.
— Est-elle conscience de son état ?
— Oh ! Très bien, mademoiselle. Elle sait qu’elle est perdue.
— Elle ne veut pas voir le prêtre ?
Les yeux tristes d’Antoinette parurent s’éclairer tout à coup.
Il faut attendre l’heure de Dieu. Nous ne comprenons pas non plus, nous, mais Lui sait le moment où l’âme s’ouvre pour le recevoir.
— Si votre maîtresse voulait, je pourrais vous soulager un peu, Antoinette... en veillant sur elle cette nuit, par exemple ?
— Mademoiselle m’a chargé de dire à Mlle Isabelle qu’elle la recevrait ce soir, si elle veut venir après avoir lu ce qu’elle lui envoie.
Sur ces mots, Antoinette se retira. Isabelle, intriguée, prit une chaise et déroula les deux feuillets couverts d’une écriture heurtée, un peu en zigzags, mais où l’on retrouvait partout les traits caractéristiques d’une nature excessive et volontaire.
« Ma chère nièce,
Tu es sans doute étonnée que je puisse, après t'avoir ignoré pendant toutes ces années, t'appeler ainsi, mais puisque je vais mourir, il faut que je libère ma conscience. Isabelle, moi seule sais vraiment comment ta mère est morte. J’étais dans le pavillon le soir où elle fut poussée dans l’étang par une femme que je n'ai pas su reconnaître sur l'instant, mais qui me fit poser des questions. Ce geste meurtrier finit par guider ma réflexion sur la femme de chambre de ta belle-mère. A cette époque, et sur l'ordre de la vicomtesse d'Argenson, elle remplaçait la dame de chambre de ta mère. Je suis presque sur que ce ne pouvait être que cette femme aux ordre de ta belle-mère.
209


 votre commentaire
votre commentaire
-
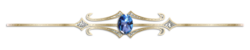
Isabelle faillit défaillir. C’était donc vrai ! Ce qu’elle pensait depuis des années, à présent, était une certitude. Sa mère avait bien été assassinée par des mains cruelles voulant sa mort. Elle arrêta sa lecture, et appuya sa tête dans ses mains. C’était bien pour cette raison que sa mère n’était pas en paix ? Après une pause et les yeux embués de larmes, elle essaya de reprendre sa lecture. Lors d’une apparition de sa mère, Isabelle avait cru que son cerveau lui avait joué des tours ; mais c’était bien la raison pour laquelle sa mère revenait de l’au-delà... Elle arrêta sa lecture, prit une chaise et appuya sa tête dans ses mains. Sa mère avait donc bien été assassinée ! Après une pause et les yeux embués de larmes, elle essaya de reprendre sa lecture. Lors d’une apparition de sa mère, Isabelle avait cru que son cerveau lui avait joué des tours ; mais c’était bien la raison pour laquelle sa mère revenait de l’au-delà ! Isabelle avait toute sa raison et ne mettait plus en doute ses visites afin de la protéger ! Elle arrêta sa lecture, prit une chaise et appuya sa tête dans ses mains. Sa mère avait donc bien été assassinée ! Après une pause et ses joues ruisselantes de larmes, elle essaya de reprendre de nouveau sa lecture.
— Pourquoi n’ai-je rien dis ? Parce que je haïssais ma belle-sœur qui était tout ce que je n'étais pas. Elle était tellement belle ! Elle me semblait heureuse et aimée comme jamais une personne telle que moi ne pourrait l’être un jour. C'était une bonne personne qui me traitait avec une affection que je prenais pour de la pitié, ce qui blessait mon orgueil. Dans mon fort intérieur, je n'acceptais pas ses gentilles attentions envers moi. Chaque fois qu'elle m'invitait à boire un thé, faire de la broderie ou qu'elle me conviait à écouter un morceau de Frédérique Chopin, je ne refusait pas, cachant, ainsi, mon ressentit vis à vis d'elle. J’étouffais ma colère derrière des amabilités, enviant sans le montrer, sa position de jeune femme aimée. Ta mère avait un véritable talent de pianiste au point de faire pleurer mon âme. J'étais jalouse. J'avais mal au point de reconnaître que je ne pleurais pas seulement en écoutant ce qu'elle transmettait par le jeux de ses jolies mains, mais aussi, sur mon sort de femme déformée. Je ne pleurais intérieurement que sur moi-même... Mon âme était empoisonnée par la jalousie. Oui, c’était de la haine qui s’insinuait en mon cœur comme un poison violent. Antoinette me disait que j’étais possédée par le diable. Maintenant que je vais m’en aller, je me dis qu’elle n’avait peut-être pas tout à fait tord et que l’enfer doit ressembler aux souffrances interminables que ressentent les damnés... Au point où en ait la maladie, je sais que j’en ai plus pour longtemps, et je veux décharger mon âme. Il faut aussi que tu saches ceci. On a tué ta mère. Qui ? Je n’ai pu reconnaître cette femme. Elle était grande et vêtue de noir, comme je te l’ai dis. Était-ce Edith d’Argenson ou sa domestique ? Je ne saurais, encore aujourd’hui, être certaine de l’identité de la meurtrière. Je ne connais pas, ta belle-mère parce que je ne l’ai jamais vue. Je m’étais déjà enfermée ici lorsqu’elle a commencé de fréquenter Monteuroux et mon frère. Mais qui donc aurait eu intérêt à supprimer ta mère, sinon celle qui convoitait sa place, son titre et qui, ensuite, s’est faite épouser si rapidement par mon frère ?
210


 votre commentaire
votre commentaire
-
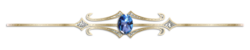
— Je t’ai déjà prémunie contre elle. Je savais par Angèle qu’elle a toujours cherché à te nuire. Si c’est elle qui est la cause du meurtre de ta mère ou qui en ait l’instigatrice, qui sait ce dont elle est capable de faire contre toi ? Prends garde ! Au cas où tu trouverais quelque intérêt à ce que soient connus les faits tels qu’ils se sont passés, use de cet aveu que je te fais. On me considérera avec raison comme une complice de ce crime, puisque je ne n’ai pas dénoncé ce dont j’ai été témoin. Tu me détesteras, Isabelle, et tu auras raison. Mais peut-être songeras-tu un peu aux tortures morales qui m’ont ravagées l’esprit depuis toutes ces années. Je ne te demande pas de me pardonner. Pourtant, je connais ta bonté d'âme. J'implore, malgré ce que tu as dû supporter depuis ta plus tendre enfance, ta pitié, mon enfant.
Victoria de Rubens »Lorsque Adélaïde surprise de ne pas voir sa protégée à l’heure du dîner, en sa dans sa chambre. Elle la trouva affaissée dans un fauteuil, toute frissonnante, ses doigts froissant la lettre de Victoria. L’horreur étreignait son âme et elle ne savait en ce moment laquelle lui paraissait plus odieuse de la confession de Victoria ? Elle avait, au moment du meurtre, ressentie une haine jusqu’à se réjouir de la mort de sa mère. Qu’est-ce qui lui semblait le plus horrible ? La femme mystérieuse qui était peut-être sa belle-mère ou bien la domestique qui avait exécuté ses ordres ?
Lorsque plus tard, entre Adélaïde et Renaud, elle se fut un peu remise de cette révélation imprévu, elle jugea nécessaire de leurs communiquer la confession de sa tante, ce qui pouvait peut-être aiguiller son cousin sur une voie intéressante pouvant aider sa défense contre le machiavélisme de la d’Argenson. Renaud jugea aussitôt que dès le lendemain, à la première heure, après avoir rapporté les ballons d’oxygène pour la tante de sa cousine, il irait faire part à William de l’étonnante lettre qu’il avait conservé précieusement.
— Le crime paraît certain après cet aveu, mais il faudrait prouver l’identité de la meurtrière, ajouta t-il. Or, en pleine nuit, elle a dû passer inaperçue... A moins que... Vous m’avez dit Isabelle, que votre vieux jardinier avait coutume de travailler quelques fois à son jardin par les nuits de pleine lune, les soirs d’été ?
— En effet.
— Il faudrait que j’aille l’interroger au plus tôt. Peut-être a-t-il vu passer cette femme dont parle votre tante, et surtout, pourra-t-il nous donner une indication susceptible de l’identifier.
— Oui, peut-être, dit Isabelle d’un air las.
Elle demeura très absorbée, pendant le dîner auquel personne ne toucha guère. En se levant de table, elle fit un pas vers la chambre, puis, se ravisa et dit à Adélaïde :
— Je monte chez ma tante.
Sa voix avait un léger tremblement. Adélaïde la suivit d’un regard anxieux que des larmes mouillaient.
— Ma pauvre petite chérie ! Murmura t-elle. Que d’épreuves et quelles révélations en ces quelques jours !
— la vie est ainsi ma chère Adélaïde. En ces instants de grande souffrance morale, Elle ne le sait pas encore, mais elle gagne son bonheur. Dit pensivement Renaud.
211


 votre commentaire
votre commentaire
-
Par La plume de N. Ghis. dans " Le mystère de l'étang-aux-ormes " Chapitre -1- page -1- le 13 Mai 2021 à 14:26
Chapitre -1-
Nous n'étions pas encore à la fin août. L’automne n'était pas loin, mais en Normandie, septembre est souvent boudeur, morose et capricieux. La jeune adolescente aimait la saison automnale lorsque la cime des arbres se couvrait de taches de couleur, ce qui lui faisait penser à des artistes peintres tels que les impressionnistes et le toucher bien spécial de leurs pinceaux. Tandis que les jours raccourcissait lentement, elle regardait la campagne se parer de ses plus beaux atours. Cela la rendait souvent pensive et mélancolique.
La jeune Isabelle vivait en symbiose avec cette nature enchanteresse. Elle ne se lassait pas d'admirer le paysage ou des myriades de petites touches colorées laissaient entrevoir la perspective d’une nouvelle saison qui se profilait doucement à l'horizon. Les premiers frimas de l’hiver n'allaient pas tarder. Isabelle était sensible aux humeurs fantaisistes des nouvelles saisons qui se profilaient tous les trois mois et principalement l’automne. Elle profitait pleinement de la sérénité qui se glissait en elle à l’arrivée de la saison enchanteresse. Pourtant, cette fois, l'été n'avait pas l'air de vouloir laisser sa place. Il prenait ses aises et se prolongeait à n'en plus finir. Les paysans n'allaient pas s'en plaindre, car l'été semblait vraiment vouloir tenir tête à la saison suivante qui, normalement, devait lui succéder. Serait-ce que la nature désirait faire un caprice et jouer sur la longévité d’un été qui refusait de laisser sa place ?
La jeune comtesse connaissait personnellement chaque paysan qui, comme toutes les année, attendaient patiemment les changements à venir en pensant aux récoltes qui allaient suivre. Cela commençait par les vendanges : les vinailles en patois normand qui tombaient en septembre et se prolongeaient jusqu'en octobre. On clôturait la fin des vendanges chaque année par la grande fête du raisin. Un grand repas était servit pour remercier tous les vendangeurs qui cueillaient les grappes, et les vendangeuses qui dans d’immenses baquets de chêne, piétinaient en chantant, les fruits gorgés de soleil. Chaque année, les premiers jus étaient servit à ce repas de fête en guise de boisson. A cette époque, les maîtres des vignobles organisaient toujours ces mêmes festivités qui mettaient fin aux vendanges. Pour les pommes, c’était la même coutume : elles se ramassaient sur le sol également à la même époque. Les cidreries attendaient donc tranquillement que les fruits soient à maturité pour fabriquer le cidre.
 2 commentaires
2 commentaires
Le Mystère De l’Étang-Aux-Ormes : Roman